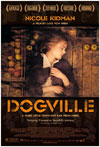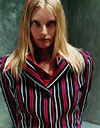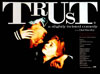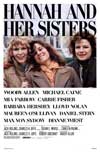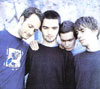les 3 Cygnes
(...de la honte...)
présentent
une pièce de
Craig Lucas
mise en scène
Cyrille Boussant
Thomas Moulins
| avec | |
 |
Tristan Romain Grandadam |
 |
Tom Emmanuel Hoblingre |
 |
Emily
Claire Le Goff |
 |
Norbert
Ronan Le Nalbaut |
 |
Libby
Elodie Martigny |
 |
Boo
Tomah Phénix |
 |
Alice
Bédite Poupon- Joyeux |
- assistante m.e.s. :
- Sophie Martin
- musique : Sylvain Cadars
- & Guillaume Armide
- décor : Jérôme Planque
- costumes :
- B. Poupon-Joyeux
- maquillages : Rafaela Auduc
- lumière : Cyrille Boussant
les Influences
Films
Timecode (Mike Figgis, 2000) : film expérimental de Mike Figgis tout au long duquel l'écran reste divisé en 4, avec un unique plan séquence sur chaque quart de l'écran. Timecode explore à l'écran ce que Je hais les… veut explorer sur scène : multiplicité de l'action, structure continu, et improvisation : en un mot un film amoureux de ses acteurs, libre comme un morceau de jazz, filmé comme une chorégraphie. De plus, un changement de ton radical survient lors du discours d'Anna Paul sur son propre travail et à travers cela sur le film qu'on est en train de voir. Ce creusement brutal de la structure narratrice est à l'image du canon final de Blue Window.
Prospero's Books (Peter Greenaway, 1992) : comme le film de Mike Figgis, un véritable traité sur la multiplicité. Le film de Greenaway est certainement l'œuvre la plus intrinséquement baroque du cinéma. Renarrant la tempête de Shakespeare, le metteur en scène surrimpressionne et surcadre les images, les inserts, les calques, les écritures, le sons. Le tout est magnifié par un travail scénographique incroyable dont on mesure l'ampleur lors du phénoménal plan séquence d'ouverture et la musique dantesque de Michael Nyman.
Shortbus (John Cameron Mitchell, 2006) : je doutais que John Cameron Mitchell puisse dépasser la représentation scénique de son transsexuel est-allemand Hedwig ; le film n'était pas à la hauteur du show. Shortbus était pour moi l'occasion de confirmer ce que je redoutais : il était l'homme d'une œuvre. Quelle erreur! Shortbus est le film le plus fin, humaniste et avant-garde que j'ai vu ces dernières années. Cameron a réussi l'impossible : sortir la pornographie du ghetto où notre morale patriarcale à 2 balles l'a relégué. La générosité du propos et de l'approche des personnages en font l'un des films le plus ressemblant à ce que je voudrais que notre spectacle soit, et le public de Shortbus est la base même du public que nous voudrions atteindre avec la pièce.
Trust et the Unbelievable truth (Hal Hartley, 1990 et 1989) : la simplicité du travail de Hal Hartley dans ces 2 films reste unique. Tous deux portent le poids et le sceau d'une très médiocre amérique New Jerseyienne qui n'est malheureusement que le probable présage de ce que le monde entier risque de devenir rapidemment. Et pourtant, Hartley infuse ses personnages archétypaux d'un brin de folie, de marginalité, si bien que si nous devions devenir de pâles copies du mode de vie américain, il y aurait pire que ces anti-héros de banlieue. De plus, Hartley a osé des répétitions meisneriennes à l'intérieur de ces deux films.
Dogville (Lars von Trier, 2003) : la transparence des décors permet d'observer tout ce qui ce passe sur scène. Tout le film est brillant, mais c'est cet aspect en particulier qui m'a influencé pour je hais les… Un cinéma qui assume et fait honneur à la théâtralité, voilà qui incite à réfléchir au cinématographisme de la scène.
Husbands & wives (Woody Allen, 1992) entre autre films : aaah! Woody et sa capacité de faire osciller ses personnages entre la carricature et le réalisme. Woody et New York. Woody et le drame. Maris et femmes est un film étrange et complexe où l'on s'interroge sans cesse sur les rapports incestueux entre fiction et réalité. Caméra à l'épaule, improvisation (ou du moins impression de…), personnages interviewés en gros plan, regards caméra, ce film est comme un scalpel placé sur 4 âmes simultanément et les ouvrant méthodiquement devant nos yeux. Enfin, ce film est l'une des apogée comique de Judy Davis. Cette extraordinaire actrice australienne réussit tellement bien à crédibiliser l'hystérie qu'elle m'a été cruciale lors de ma recherche sur Boo.
Les films choraux (Hannah & ses sœurs, 1986 ; Shortcuts, 1993 ; Magnolia, 1999 ; entre autre) : Les films choraux sont ces films où l'on ne suit plus de manière rigoureuse un personnage et ses déboires mais un groupe de gens tous d'égale importance. Ma première et mémorable expérience dans ce domaine fut Hannah & ses sœurs. En 1987, je découvrai ce nouveau style de narration et le trouvais absolument brillant. Si bien des films auparavant avait exploré cette technique, c'est ce Woody qui l'a rendu si fascinant pour moi : d'une part il était centrer sur l'un des Edens que je poursuivais, New York City, mais en plus la mosaïque de personnages décrits avec leurs banales mésaventures quotidiennes était dans la parfaite lignée de mes préoccupations d'ado de 15 ans : l'art, l'amour…
7 ans plus tard, Short cuts venait réexplorer cette structure, mais la poussant un stade plus loin. On passe à plus de 20 personnages principaux et, par delà les 3h d'intrigues, chacun réussi à exister pleinement, mieux, nous plongeons dans la spirale de son médiocre drame. Le cast est absolument et intégralement époustouflant.
Quand Magnolia sort, 5 ans plus tard, je ne pensais pas que ce mode narratif puisse encore se renouveler. Mais avec évidence, le film de PT Anderson prolonge la stylistique de Short Cuts et la réexplore à sa manière, transformant le film en un implacable tourbillon qui entraîne chaque personne au cœur d'une douleur incommensurable.
C'est bien de tous ces films dont Timecode est le parfait l'héritier. Et Je hais les dimanches soirs par la même occasion.
Lisa Kudrow (Phoebe) dans friends : elle l'a fait. Lisa Kudrow a réussi à créer un rôle a la fois complètement hillarant et excessif, en restant pourtant complétement plausible, charmant, humain. Elle a dépeint LA barge de telle sorte qu'il n'est plus possible de s'aventurer sur ce terrain sans l'y croiser quelque part. Merci pour cet humour décapant, ce timing incroyable, cette voix à côté de la plaque, ces petites grimaces et tics faciaux, cette silhouette maladroite et dégingandée. Une partie non négligeable de ma veine comique lui doit une fière chandelle.
le rÔle de Boo
Tilda Swinton : mon égérie ; la perfection incarnée, elle joue des personnages masculins ou féminins selon l'humeur, mais surtout en montrant à quel point la catégorisation sexuelle est obsolète. Depuis Edward II et Orlando jusqu'à the Deep End ou Constantine, pas une de ses apparitions ne laisse indifférent. Boo est un hommage continu à Tilda Swinton.
Angelica Houston : C'est terrible à dire mais c'est parce qu'elle est si laide qu'elle m'a insufflé suffisamment la confiance en moi nécessaire pour jouer Boo. Et quand je dis laide, je parce du sens strict et hollywoodien du terme, car Angelica Houston, d'une certaine manière, est incroyablement belle, d'une beauté unique, originale, imposante. Je me suis dis que si je visais à créer une telle personne, ce genre de femme qui dépare des définitions classique de la féminité, dépassant l'égo de vouloir être belle en tant que femme, je ne pouvais que réussir.
Transamerica (Duncan Tucker, 2005) : la prestation de Felicity Huffman est bien entendu géniale, mais c'est surtout de son incroyable travail sur sa voix dont je me suis inspiré pour Boo. Actrice mametienne par excellence, Huffman est la meilleure (si ce n'est la seule) chose à prendre dans Desperate Housewives, et a créé le rôle principale de Boston Marriage au côté de Rebecca Pidgeon. Sinon le film est plutôt pas mal foutu, et Kevin Zegers, en plus d'être absolument craquant, donne à son rôle une profondeur inattendue.
Breakfast on Pluto (Neil Jordan, 2005) : c'est la composition de Cillian Murphy dans le film qui m'a décidé à tenter de jouer Boo. Son travail sur Patricia "Kitten" Braden est une telle évidence que je me suis dit que certains rôles et certaines prestations dépassait le genre sexuel.
Singing (de Matthew Hurt, mise en scène par Aurélia Nolin, 2004) : le premier rôle féminin que j'ai créé. Une expérimentation qui m'a permis d'explorer une identité sexuelle intermédiaire entre celles de l'homme et de la femme.
Sarah Polley : la jeune actrice la plus extraordinaire du moment. Je le savais déjà en allant voir the Secret life of words. Je suis sorti bouleversé. Elle se tire d'un monologue d'une bonne quinzaine de minutes, quasiment en plan fixe, sans musique, sans effet, sans flashback, et livre la prestation la plus sincère, la plus émouvante et la plus politiquement forte de l'année. 24 ans et du talent qui ne cesse de se confirmer. Sa sincérité est une vraie source d'inspiration. Puis elle réitère dans Don't come knocking.
Hedwig : je l'ai vu 3 fois à New York (dont 2 fois avec JC Mitchell). Inutile de dire à quel point tout le East Village et le Lower Eastside était fou de Hedwig. À l'époque, un metteur en scène qui fréquentait JC Mitchell m'a conseillé d'aller auditonner pour reprendre le rôle en Europe. Rentré en France, j'ai vu le film, avec déception. Et voilà que depuis 6 mois j'entend parler de la production française de Guillain Roussel avec Matthew Bonicel par au moins 4 personnes différentes. Je finis par revoir le spectacle et me rappeler de quoi parle cette odyssée caustique d'un être pour s'accepter quelle que soit son identitée et trouver celui qui l'acceptera malgré tout. Parfait pour un mek qui culpabilise de s'être distribué le rôle d'une lesbienne dans une pièce réaliste. Le destin non ? En plus, me voilà re-metteur en scène du spectacle, qui se joue le 9 mars à l'Espace Cardin !
Jamie Lee Curtis : c'est par le ragot autour de sa naissance que Jamie Lee Curtis m'a inspiré. Une fois accepté le fait que j'allais jouer une femme, il me restait à actualiser la raison pour laquelle la plupart des gens dans le public allait me prendre pour un homme, un homme à demi ou mal travesti. Alors m'est revenu cette histoire que j'avais entendu sur l'actrice américaine qui serait née, comme ça arrive parfois, hermaphrodite. Ses parents auraient choisi de l'emputer de son pénis et de la doper aux hormones féminines pour lui éviter cette difficile marginalité. Je me suis dit qu'il pouvait s'agir exactement de l'histoire de Boo, née à la fois homme et femme, et devenu femme par décision de ses parents mais n'ayant jamais atteint à un état de paix et tranquilité vis-à-vis de ce choix subi. Elle est encore certainement sous traitement hormonaux et se considère souvent comme un monstre.
Brenda et Criquette : et oui, les héroïnes du Cœur a ses raisons ont également joué un rôle dans la création de Boo. Brenda n'est-elle pas l'une des plus belles femmes du monde? et Criquette l'une des poitrines les plus oppulentes. En fait, ces 2 acteurs de génie nous prouvent à chaque épisode que tant que c'est assumé, on peut tout se permettre (mmâââ laise). Concrétement, pas une répète ne s'est déroulée sans un petit délire provenant des uns ou des autres des gags en cascade de cette série québecquuhâââse.
Chansons
All the trees in the world will clap their hands (Sufjan Stevens) : entendue à la fin d'un épisode de Weeds, cette chanson est devenue un hymne intérieur. Elle respire une telle candeur, si triste, si pleine, si simple. Elle m'a inspiré l'idée et le rythme du canon final (et correspond pour moi à une forme du ton de la pièce).
Tiny apocalypse (David Byrne) : celle-ci termine the Secret life of words et nous permet de re-sortir de ce terrible et anodin voyage au sein de la barbarie humaine. Une chanson incroyable, des paroles terribles mais un rythme entrainant, presque gai, comme si le seul moyen de parler de ces petites apocalypses, c'est de les prendre avec un sourire résigné aux lèvres, une grande inspiration et le regard humide de Sarah Polley.
Sigur Rós : leur musique est bien celle des anges. J'ai été voir leur concert durant le premier travail sur la pièce. Et soudain, au cours de ce concert bien agencé mais sans grande surprise, un break, dans l'une de leurs chansons les plus connues. Un break qui dure. qui dure. qui dure… … qui DURE … qui … et soudain, le contact, la commnunication entre eux et nous, eux, là-bas, et nous, ici, devient palpable, texturelle. Alors j'ai eu une révélation : nous devons surprendre, désarçonner, renverser ce que les gens attendent de nous et du théâtre. C'est une évidence, peut-être, et pourtant. Un message des anges : c'est parfois dans le silence qu'on se rencontre le plus profondément.
Wise up (Aimée Mann) : cette ballade est l'une des 2 musiques que nous avons proposé à Sylvain pour composer la chanson d'Emily. Triste et mélancolique, c'est encore une fois grâce à sa simplicité qu'elle échappe au sentimentalisme. De plus, elle occupe, comme la chanson d'Emily, une place à part dans le Magnolia de PT Anderson puisque soudain, tous les acteurs, successivement, se mettent à la chanter, choix qui semble-t-il en avait gêné certains (Tom C!?), jusqu'à ce que Julianne Moore vienne au secours du réalisateur et n'insiste pour que tous s'y plient. En résulte l'un des moments de grâce du film.
Strong enough (Sheryl Crow) : autre musique proposée à Sylvain, pour lui inspirer la complainte d'Emily. Calme triste résigné à la rencontre entre folk, country, pop.
thÉÂtre
l'écriture de David Mamet (et Sam Shepard) notamment celle de Boston Wedding : découvrir l'écriture de David Mamet, c'est un peu comme se prendre le tgv en pleine gueule. Ces dialogues, cette destructure complètement réaliste de phrases entrecoupées, avortées et imbriquées, C'EST la conversation. Simplement. Voilà ce que Mamet parvient à faire dans son art. Il capture cet hydre qui a échappé à tous les auteurs dramatiques jusqu'à lui, et la fait couler sous sa plume, avec un naturel tel qu'il désarçonne, qu'il semble outrepasser ses prérogatives. Le naturel semble s'être laissé corrompre par la gymnastique dramatique que Mamet lui impose ironiquement. Il est à la fois absolument parfait, et trop parfait. Trop parfaitement vrai. C'est incroyable, déconcertant. De tout les textes de lui que j'ai lu, un mariage bostonnien me semble le plus abouti. Sur ses traces (du moins je l'ai découvert après), Sam Shepard réussit ce même exploit dans certains de ses textes. Quelle ne fut pas ma surprise en découvrant que Blue Window, dans la même lignée, date en fait de 1984!
la poésie de Tennessee Williams : Tennessee, dont nous avons décidément tous quelque chose (sauf peut-être certains français trop prétentieux) est un poète unique, inégalé au XXème siècle. Sa capture de la fêlure (et failure), de la fragilité humaine dans l'amérique métamorphosée de l'après-guerre, ses losers au pays des battants, ses tristes mammifères de sensibilités, en voix de disparition, permettent au pays de capitalisme claironnant d'avoir une âme, une vraie, et peut-être l'une des plus universelle de son temps. Son influence vit dans tout le théâtre réaliste qui l'a suivi.
les stages d'Aurélia Nolin et de the Institute of the Performing Arts : je dois à Aurélia, outre le monologue de Singing et le Broken windows de Robert Bella, ma découverte et ma pratique de Meisner. Pour ça un immense merci et une immense influence. Et puis pour revenir aux sources, c'est à Londres lors de mon premier stage avec Aurélia que j'ai découvert la production de Blue Window dirigée par Scott Williams.
Sandford Meisner : en 2004, au terme de plusieurs années de galère sur le plan artistique et théâtrale, j'ai besoin d'un renouveau, quelque chose d'énorme, de grandiose. Cette année-là, je commence à enseigner à des adultes. Mais moi-même, je fonctionne sur mes réserves. Alors je croise le chemin d'Aurélia et, indirectement, de la technique mise au point par Sandford Meisner. Je vous laisse consulter des sites largement mieux renseignés que moi sur sa vie et son évolution. Mais ce que je retire de cet enseignement grâce à mes stages avec Mike Bernardin, Robert Bella et Sophie Vaughan, c'est le miracle que j'attendais : une redistribution totale de mes connaissances du jeu théâtral avec comme nouveaux objectifs l'écoute de l'autre (mais pas au sens convenu de la chose), l'inattendu, l'ouverture à l'instant présent et surtout la recherche de la spontanéité (celle si conscienscieusement annhilée en quelque 15-20 ans d'éducation). Dès mes premiers 'repetition exercices', je me suis jeté à corps perdu dans cette technique sans laquelle je ne débute jamais un cours ou une répétition. Notre travail de Je hais les dimanches soirs n'existerait pas sans Meisner et son enseignement, et m'a permis d'atteindre en décembre une nouvelle épiphanie en tant qu'acteur et personne.
Michael Chekhov : quoiqu'élève de Stanislavski, Chekhov est quasiment son antithèse. Il n'est que délire, métaphore et imagination. Et pourtant, une évidence complémentaire de son maître. C'est Floyd Rumohr qui l'a fait rentré dans ma vie à travers la production de King Lear, en 1999. Et là aussi, le choc a été de taille. À travers la méthode de Chekhov, le corps devient matière, l'espace scénique devient chorégraphie, les personnages animaux et les actions boules de feu ou bulles de mousse. Le jour où j'ai commencé à pouvoir utiliser ces précepts, j'ai achevé la première étape de ma formation d'acteur. Mais c'est en observant Floyd Rumohr travailler que j'ai réellement posé les bases de ma recherche de metteur en scène.
&
Irene Moore : mon professeur de théâtre à New York University pendant 3 ans est certainement la personne à qui je dois la simple possibilité de mon talent. Terrible, intransigeante, redoutée et cependant incroyablement perceptive, réceptive, humaine, elle nous a transmis, au cours des nombreux semestres de sa classe de scene study, la base même de la technique Stanislavskienne sur laquelle est basée tout le théâtre américain moderne. Je me souviendrais toute ma vie de mon premier cours avec elle, du choc, de l'émerveillement, de l'intimidation. La page du théééâââtre à la française, vague et intuitif, était tournée ; nous rentrions dans le travail, le vrai, tel l'artiste qui plonge les mains dans la glaise ou qui accorde son instrument. Et pour couronner le tout, au terme de triomphes et d'engueulades, de remerciements et de ruptures, un jour, une épiphanie, et la méthode se met à vivre entre mes mains comme un reptile à la peau tiède. Elle se met à me servir et non l'inverse. Et Irene de me dire alors : tu es l'un de mes élèves qui a le mieux intégré ce système que j'enseigne.
New York City, où j'ai vécu 5 ans. Qu'ajouter? Nyc entre 22 et 27 ans. Entre 1995 et 2000. Pour un homo lyonnais mal dans ses pompes, c'est le plus grand cadeau de monde. Une révélation, un monde meilleur. Ma vie là-bas, j'y repense et c'est un film. Comme un film… Avec une sacrée intrigue, des personnages hauts en couleur, des décors pas croyable, des variations de tons. Je sais que ma mémoire a fait un excellent travail de montage, mais il n'y a pas que ça. Alors oui, je suis re-né à New York. Et je souhaite ce genre de renaissance à tout le monde. On me demande souvent pourquoi je suis rentré. Il y a bien des raisons, mais je répondrai par une pirouette en disant que tout film a une fin.